

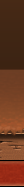
Progression : 0/100
Niv. expérience : 1
Niv. expérience : 1


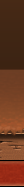
|
Partie 5.0 : Le départ (bis)  Un départ, c’est une naissance.  Nous arrangeons nos affaires, une par une, dans un silence amer. Nous dépoussiérons de vieux souvenirs tachés de sueur. Nous armons nos chaussures trouées de part et d’autre. Nous blindons notre coeur, nos nerfs, nos vies, pour éviter la casse, comme on le dit souvent ici.  Pour moi, la route était encore vague, mais le Corbeau décollait vers l’Est, indiquant le chemin que tracerait mon destin. Comment en douter ?  Je préparais mes paquetages. Une vieille boîte de tomates concassées en conserve, mon tournevis rouillé, mes trois gourdes - dont une à moitié vide - ma radio, mon revolver, ma vieille bibliographie, une corde abîmée trouvée dans la grotte, quelques étoffes de tissus divers, une poignée de piles à moitié déchargées, le vieux sac de papier où j’avais déposé un reste de croûton de pain qui prenait des teintes verdâtre ici et là , et une incomplète gorgée d’espoir.  Quoi ? Oh, vous avez remarqué mon revolver. C’est-à -dire que... je n’en ai jamais utilisé. J’avais été policier pourtant. Distribuer des amendes, les contrôles d’identité, les tours de garde, tout ça, je m’y connais, mais je ne m’étais jamais servi de mon arme, pour tout vous dire. Quand l’heure du départ hurla, je l’avais même oublié dans son tiroir, soigneusement rangé avec une trentaine de cartouches dans sa boîte de métal polie, lamellée et courbée sur les cotés. J’ai sûrement fait un heureux, si quelqu’un est passé dans mon petit appartement. Sûrement avait-t-il comme moi été bercé par l’odeur des vieux murs, de la poussière, du produit détergent qui me rendait si nostalgique.  Il avait dû trouver le pistolet, son chargeur à roulette, sa couleur métallisée, sa forme qui accueillait si bien la paume tremblante d’un homme. Il avait senti ce courant de puissance, cette énergie, cette force, quand il l’avait saisi. Il avait rempli méticuleusement le gros barillet, graissé la caisse, tenté la gâchette, comme un enfant avec un jouet en plastique. Il avait probablement joué avec le chien, appréciant les courbes sinueuses du Python avec une grande attention.  J'espérais au fond de moi-même qu’il aura été plus pétulant après qu’avant ma fuite.  J’avais soigneusement emballé mes pieds dans des sacs de plastique sur lesquels j’avais préalablement uriné pour éviter les cloques, enroulé la corde autour de moi, en diagonale, et tenais fermement les deux sangles de mon sac de cuir solide.  Le Corbeau avait volé vers l’Est, vers ce soleil qui pointait ses premiers rayons.  La Marche allait débuter.  Mes pieds foulèrent le sable de ce pas si rébarbatif, brisant les ondes vulgaires des dunes symétriques rougeoyant sous le globe Lumière. Mon coeur bondissait dans ma poitrine. Mes mains se crispèrent de plus belle sur les bandes brunies et humides. Mes yeux clos se plissèrent. Les poils de mes bras s'hérissèrent sous la caresse du vent frais et matinal. Mon esprit se vida.  J’expirai pour la première fois.  Ainsi.  J’étais né. Â-...-  Partie 5.1 : L'homme sombre  La marche était longue.  Ce vieux soleil burgrave était là , silencieux, vide de toute compassion. Il observait, j’avançais. J'avançais, il m'observait. À ce rythme, mes pieds s’enfonçaient dans le sable, en laissant derrière eux de profondes traces comme si ç’avait été de la neige dans laquelle j'ambulais calmement. Un froid dément envahissait mon âme, sous l'astre de plomb qui me dessinait ce chemin – destin - au loin. Quand on marche longtemps dans le désert, on abandonne la notion du temps, de l’espace. On se perd, on se retrouve. On tourne en rond. On pleure, puis l’on rit. On a soif. On a soif. Ici une Cadillac sale et abandonnée. Là , la dépouille d’un vieux cerf. Plus loin, c’est un foyer délabré ; un toit effondré, des murs décrépis, des fauteuils de cuir rongés.  Pas un instant, la pluie ne se décide de tomber. Pas un instant, le paysage ne se mue. Pas un instant, l’on désire s’arrêter, et risquer de ne plus repartir. Les sables ont ce charme-ci, comme le calme d’un cimetière, un lit chaud, la chaleur d’une femme nue qui se mue contre notre corps. Dès lors qu’il submerge notre vue, il s’en prend aussi à notre esprit. Une prison de lumière. Dorée. J’étais là sans vraiment m’y trouver – l'esprit vagabond et drogué. Mes pas étaient guidés par l’instinct, par l’instant.  Se sont dirigés vers l’Ouest opposé trois personnes qui croisèrent ma route.  La première était un prêtre, reconnaissable à sa soutane noire, et sa Bible reliée d’un cuir sombre qu’il tenait fermement en main. Lorsque nous nous sommes croisés, il ne m’a pas adressé sa bonne parole, les yeux rivés sur l’horizon, et les doigts martyrisant systématiquement le lourd recueil. Il frottait ses ongles gras contre la couverture - on y voyait les marques des griffures, comme si une bête en aurait voulu extraire le Savoir - aussi fort qu’il lui était donné de gratter. Sa mine de camard, avec ce vieux nez raccourci et ces cernes violettes, ne s'éloignait guère de son noir domaine. Il semblait tout droit sorti d'un enterrement d'enfant, ou d'un autre sermon sur les marances de son Dieu. Ses pas étaient saccadés, maladroits, pris dans les plissures de sa disgracieuse robe d'ombres. Il avait aussi la taille de l'emploi. Grand et fin, la cinquantaine bien atteinte. L'effort avait creusé dans son front de profondes digues de peau, où la sueur perlait sans cesse, comme ce haut barrage Hoover, ses larges fondations de béton et sa face démesurée – le produit du sang des ouvriers de McKeeversville. Ces sourcils gris, ce menton carré, ces lèvres sèches. Ah, et ces yeux. Rougis par un sable qui ne connaît pas le sommeil, verts comme la pomme que l’on arracha de l'arbre. De vrais yeux de déments.  Le prêtre ne m'adressa donc qu'un silence rituel, puis continua sa marche sans daigner se piquer d'attention pour le pauvre pêcheur qui a fort sur la conscience. La religion s'estompa dans le lointain, sans laisser autre souvenir que celui de vieux ongles brunis par la crasse, grattant désespérément la couverture de leur Livre, dans un frotti-frotta incessant. Comme le grincement déchaîné d'une craie contre un tableau. Comme le gémissement d'un animal affamé, dehors. Comme le bruit perçant d'un cri dans une nuit froide, interminable. Partie 5.2 : La femme aux yeux bleus Le deuxième personnage qui coudoya ma route fut cette femme aux longs cheveux gris et lisses, abandonnée dans une blouse colorée d’un blanc loin de candide, et qui avait perdu l’éclat de son sourire depuis peut-être vingt ans déjà . Dans ses mains se présentaient cet épais volume bleu, où des lettres latines dorées étaient inscrites - illisibles sous sa paume -, ainsi qu’un maigre stylo-bille rouge qui tremblait dans cinq doigts frêles et asséchés par la roche dans le vent. Elle avait des yeux bleus - un bleu magnifique - qui roulaient dans leurs orbites, étudiant chacune des collines, pierres, ou grains de sable qu’ils étaient en mesure de découvrir. Sa peau se fissurait comme du plâtre au soleil, craquelée de mille et un creusets, rêche, poreuse ; elle était comme le vieux galet pas tout à fait lisse que l’on trouve sur les plages de rocailles, à la lumière de l’aube, et que l’on perd dans sa poche, puis que l’on retrouve et frotte méticuleusement contre le pouce et l’index sur le chemin du retour. Ses joues creusées par la faim remuaient dans le vide en espérant par quelques danses mystiques et sacrées invoquer un humectage tant requis. À son oreille droite, une petite perle blanche soutenue d’un fermoir en or, célibataire. Dans une démarche saccadée, à la fois lente et nerveuse, elle s’approcha de moi, un pas après l’autre, en faisant fondre sur son visage un sourire fou et ébahi (mais plein d’espoir). Elle avait une certaine beauté, malgré son âge, qui s’échappait de ses yeux bien ronds. De gros yeux couleur ciel, captivants, surréalistes. Comme une nuée d’oiseaux qui s’envolent pour rejoindre le sud l’hiver venu. (citation) Vous l’avez vu ? Je ne comprenais pas. (citation) Vu quoi, madame ? Là , elle tergiversa et traça l’horizon par son index, du Nord-Est vers le Sud-Est, dans un mouvement régulier, une ligne nette qui s’étalait sur la séparation floue entre ciel et terre. Dos à moi, elle tremblait. (citation) L’ombre de la Bête, regardez ! Elle est là , elle nous suit... Ses longs cheveux cachaient sa nuque dans une masse grise et blanche, dessinée de petits cercles. Pas plus épais que la largeur d’un pouce. Sa voûte était immobile - froide - et ses fesses étaient maigres, frêles. Sa blouse chiffonnée s’arrêtait un peu en dessous de ses genoux, puis le reste de ses jambes était caché sous un vieux collant troué. À ses pieds, des chaussures, des rangers brunes munie d’épaisses semelles noires qui n’avaient pu être trouvées que - par hasard je l’espère - sur la dépouille d’un militaire malchanceux. (citation) Elle nous observe... Rapide comme la mort. Froide comme la mort. Noire comme la mort. Son sang est un poison. Sa chair est pourrie. Son coeur est décomposé. Ah, et son visage... Défiguré par le temps. Son poil terne. Ses yeux injectés de sang. Non, il ne faut pas qu’elle nous voit ! La panique avait pris part d’elle. La vieille femme se tournait, se retournait, balançait ses bras de l’Ouest à l’Est. Elle dévoila par accident l’inscription dorée de son livre ‘’Science humaine et végétale’’, puis ses mains remontèrent et cachèrent à nouveau la couverture. Alors, elle se mit à murmurer au lointain cette vieille comptine, tout en continuant sa danse mystique et affolée. Un rictus triste et horrifié Oh oui, elle crevait de trouille ! (citation) Apopis est ce vilain serpent vert, (citation) Tu n’es qu’une vieille folle... Je dois avancer. Elle arrêta de chantonner, et me fixa de ses yeux bleus grand ouverts. J’en avais déjà vu des comme ça auparavant... Ces yeux qui fixent suppliant, à qui l’on ne peut refuser sans d’énormes sacrifices, d’énormes pertes. [Lumières et flashs assourdissants] (citation) Tu m’avais promis que tu resterais ici quinze nuits encore... Ses yeux bleus me fixaient, tristes comme jamais. (citation) Tu vois très bien qu’il n’y a plus rien à faire... Même George est parti. Il faut être raisonnable, et puis... les barricades ne tiendront pas éternellement. Ses mains avaient pris les miennes, et les avaient collées contre son jeans bleu, ses anches fermes et agréables. (citation) Mais tu m’avais promis... Tu ne veux pas me laisser seule quand même ? Ses mains s’étaient serrées plus fort. (citation) ... Viens avec moi alors ... Elle avait soudainement lâché mes paumes, qui avaient glissés sur son corps pour s’arrêter contre le mien. (citation) ... Oh ... Non, ça je ne le peux pas. Ils ont besoin de moi, de nous. C’est ici notre place. Tu dois rester. Je t’en prie. (citation) Je ne veux pas mourir si tôt, et toi non plus. Partons. On a plus aucune chance ici... (citation) Je ne peux pas. Je ne peux pas , les mots résonnaient dans mon esprit, comme un blessure à vif que l’on couvre d’alcool à cicatriser. Elle ne pouvait pas, non. Si elle m’avait accompagné, à ce moment, je ne sais pas comment mon destin aurait tourné. Peut-être moins de violence, peut-être moins de sang. Peut-être plus. L’inconnu le restera pour une éternité encore. Et aujourd’hui, il m’arrive de me demander si je n’aurais pas dû l’écouter, ce jour-là . Ça peut sembler bête mais... Je l’aimais. Je revenais peu à peu au moment présent. La vieille femme était toujours là , et avait recommencé sa comptine. Apopis, ce vilain serpent vert, fruit de la folie... Je n’avais pas de temps à perdre. Lentement, je rehaussais mon sac, vérifiais mes lacets, pris une gorgée d’eau chaude de ma gourde, et m’éloignai. La femme hurla de tout son cÅ“ur : (citation) Tu ne veux pas me laisser seule quand même ?! Je me retournai, et refis cette erreur qui auparavant m’avait coûté si chère. Il était trop tard. Je marchais vers l’Est, seul. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Partie 5.3 : Le soldat jeune Le troisième était là . Immobile à un coin d’ombre. Silencieux et rêveur. Assis sous un arbre défeuillé par le vent du sud, un vieux chêne bien sec qui sonnait creux quand on tapait dessus. Il était maigre, et ses bras noircis par le soleil, abîmés. Dans l’ombre des branches, entouré de corbeaux déplumés qui s’agitaient mollement autour de lui, lâchant quelques fois des cris crus et perçants, comme leurs yeux rougis par le soleil. La chaleur ne troublait pas son sommeil, ni les croassements, ni aucune présence. De son uniforme vert et kaki, il ne manquait plus que les deux grosses rangers qui avaient quitté ses pieds, pour trouver un parfait soldat roupillant. Son casque était fixé sur ce qu’il lui restait de cheveux, maintenu par la petite lanière de cuir qui filait sous son menton, et ses yeux clos. Son arme était au sol, abandonnée. Pas de munition. Sa gourde, vide. Un corbeau vint se poser sur son épaule, et me fixa de ses deux fragments de rubis. Il croassa. Le bruit s’envola loin avant de s’éteindre dans les sables sans fin. Mais le corbeau ne cilla pas. C'est un trou de verdure où chante une rivière, Accrochant follement aux herbes des haillons D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un somme : Nature, berce-le chaudement : il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. [Jean Nicolas Arthur Rimbaud] |